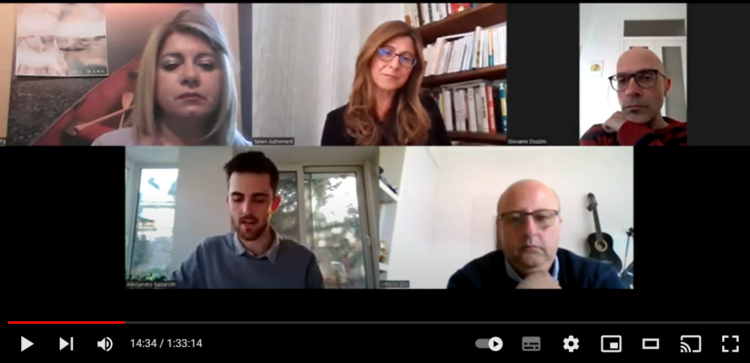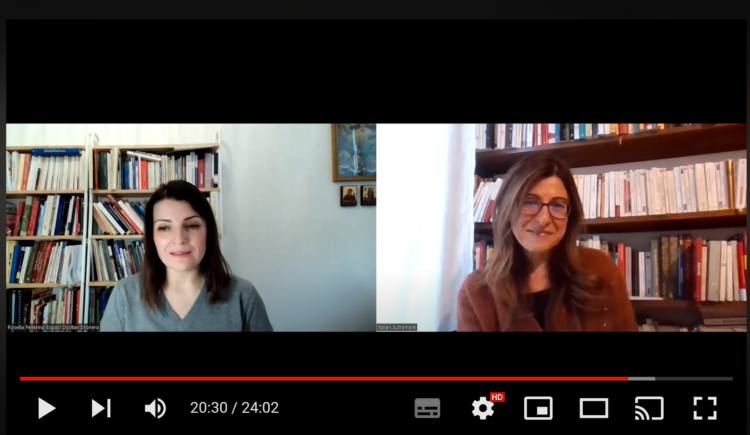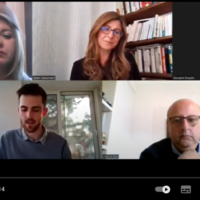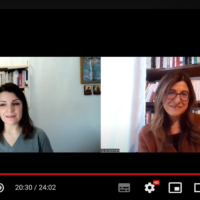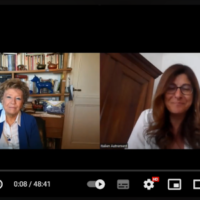Après avoir enseigné dans des lycées, Christophe Mileschi est devenu maître de Conférences à Nancy (1993) puis Professeur de littérature italienne contemporaine à l’Université Stendhal-Grenoble 3 en 2001. Il est l’auteur d’un ouvrage sur Dino Campana et d’un essai sur Carlo Emilio Gadda. Il a publié dans différentes revues spécialisées et a réalisé plusieurs traductions d’auteurs italiens. Il a écrit « Morts et remords » essai sur un écrivain italien qui se repent, au terme de sa vie, d’avoir contribué à l’horreur de la grande guerre et du fascisme et « Le Clown amoureux : l’œuvre cinématographique de Roberto Benigni (La Fosse aux Ours, 2007). Il est aussi passionné de musique et de théâtre.
Ton nom nous fait supposer que ta première rencontre avec la langue italienne a eu lieu en famille. Est-ce vraiment ainsi ? Veux-tu nous en parler et nous raconter le parcours pour devenir enseignant d’italien et traducteur ?
Je tiens mon nom de famille de mon grand-père Giuseppe Mileschi, qui est venu en France, dans le Nord, au début des années 1920 avec un frère cadet et deux sœurs (sur une fratrie de huit), en quête de travail. Ils venaient de Vénétie, de la région de Vicence, qui jusque dans les années 1950 était une terre d’une extrême pauvreté. Mes ancêtres italiens étaient des paysans sans terre, des braccianti, des serfs de la glèbe. Mon grand-père a bien réussi son intégration : il s’est marié à une maîtresse d’école française. Une vraie promotion sociale ! Et il a très bien appris le français, au point qu’il n’a jamais parlé italien à la maison. Par conséquent, chez moi non plus on ne parlait pas italien. Mais je l’ai entendu ici ou là dès mon plus jeune âge, dans la bouche de mon grand-oncle Vittorio (on l’appelait ziò Victor, c’était le petit frère de Giuseppe) et de ma grand-tante Maria (zià Marià, la grande sœur), ou quand on allait voir les cousins en Italie. Enfin, non, je pense que ce que j’ai entendu, ce n’était pas de l’italien, mais le dialecte de Montecchio Maggiore, leur village près de Vicence, ou à la rigueur un mélange de dialecte et d’italien. J’ai appris l’italien à l’école, en classe de quatrième, presque par hasard. Et tout de suite, vraiment tout de suite, j’ai su que j’étais chez moi dans cette langue. J’ai eu envie dès la quatrième d’être prof d’italien. Mais on m’en a d’abord dissuadé, « pas de débouchés ». Alors j’ai fait autre chose. Et puis ça m’a rattrapé : alors que j’avais bouclé un cycle d’études qui n’avait rien à voir, j’avais plus de 20 ans, j’ai retrouvé mon premier désir : je me suis inscrit à l’université en italien. Et c’était parti. Agrégation, doctorat, etc.
La traduction aussi c’est venu presque par hasard. Je suis devenu traducteur au début des années 90 en écrivant ma thèse sur un poète italien, Dino Campana, auteur d’un unique recueil, Canti Orfici (Chants Orphiques). Pour les besoins de la thèse, je devais citer des passages de son œuvre. L’usage veut qu’on cite en langue originale, mais en donnant la traduction française. Si une traduction a été publiée, c’est à elle qu’on renvoie. Dans ce cas, souvent, la traduction française ne « collait » pas avec les besoins de mes analyses. J’ai donc dû retraduire ou réaménager un certain nombre de passages. En retraduisant, j’ai découvert que la traduction était aussi une manière de comprendre en profondeur et d’analyser un texte. Après ma thèse, j’ai décidé de publier ma traduction du recueil sur lequel j’avais travaillé. Quelques années plus tard un éditeur m’a contacté en me demandant si je voulais traduire des textes de Léonard de Vinci. Et c’était parti.
La traduction comporte plusieurs phases dont celle initiale qui est le choix d’un auteur et d’un livre. Comment cette phase se passe-t-elle ? L’éditeur contacte le traducteur ou bien celui-ci s’éprend d’une œuvre ou d’un écrivain et décide de les traduire ?
Ma réponse sera sans doute décevante : presque tout ce que j’ai traduit vient de commandes de la part d’éditeurs. Mais ce sont malgré tout des textes que j’ai choisis, parce que je n’accepte pas tout ce qu’on me propose sans distinction. Il faut que le texte me plaise, m’enthousiasme, que j’aie avec son auteur une sorte d’affinité, d’intimité. Comme j’ai un autre métier, prof à la fac, je ne traduis pas pour payer mon loyer, je peux donc me payer le luxe de ne traduire que ce que j’aime, ou à peu près.
De temps en temps je croise un livre en italien et je me dis « ah, j’aimerais traduire ça ! » Mais le plus souvent il est déjà traduit. Je n’ai malheureusement pas beaucoup de temps à consacrer à la prospection et à la proposition de projets aux éditeurs. J’ai déjà fort à faire avec les traductions qu’on me confie…
La traduction fait voyager les lecteurs. Sans la traduction, les livres ne dépasseraient les confins géographiques d’un pays ou ceux de lieux encore plus restreints. Comment prendre en compte tous les aspects linguistiques et culturels sans en trahir le texte initial ?
Il est impossible de ne jamais trahir. Par définition, quand on passe d’une langue à une autre, même quand il s’agit de langues proches comme l’italien et le français, on fait une opération de transfert linguistique et culturel dans laquelle il y a forcément de la « perte », si on veut appeler ça comme ça. D’un autre point de vue, il peut aussi y avoir du « gain », d’ailleurs. Si je dis « piove », je vais traduire par « il pleut », mais voilà qu’en français je fais intervenir, parce que la grammaire française m’y oblige, un pronom sujet, ce « il » étrange qui pleut, qui n’est rien, qui n’est personne, mais qui désigne quand même, grammaticalement, un sujet actif. Si je traduis un texte où il est question de La Settimana Enigmistica, comment faire ? Pour un Italien, la référence à cette publication est immédiatement limpide, suscite aussitôt des images, des émotions, des idées, des souvenirs, des pensées, etc. En revanche, pour un Français qui ne connaît pas l’Italie, ça ne signifie absolument rien. On peut mettre une note explicative, mais c’est une rustine, ce n’est jamais satisfaisant, et ça compromet de toute façon la lecture, le rapport du lecteur au texte qu’il lit ; et quoi qu’on écrive dans la note, rien ne pourra remplacer les images que suggère le simple titre Settimana Enigmistica dans l’esprit d’un lecteur de culture italienne. Donc on se débrouille, au cas par cas, on trouve des solutions en fonction du texte qu’on est en train de traduire, des solutions qu’on ne pourra pas nécessairement appliquer telles quelles la prochaine fois qu’on rencontrera le même problème : parce que ce ne sera pas le même problème, justement, mais un problème différent se posant différemment dans un autre texte. La traduction, c’est une science empirique.
Restons dans la thématique des voyages. Un traducteur peut exercer son activité depuis chez lui, sans connaître physiquement les lieux dont il est question dans les livres sur lesquels il travaille. Elio Vittorini, si je ne me trompe pas, avait traduit de grands auteurs américains sans jamais se rendre aux Etats Unis. Est-il important pour toi de voyager pour t’imprégner de l’atmosphère des lieux ?
Je prends encore le risque de décevoir : non, je ne pense pas qu’il faille nécessairement connaître les lieux d’un livre que l’on traduit. De même, je ne pense pas qu’un écrivain doive connaître un pays pour y situer un roman. Il y a bien d’autres façons de « connaître » que l’expérience pragmatique. La littérature est en soi une façon de voyager, d’expérimenter des lieux.
Aujourd’hui nous vivons dans l’ère de l’informatique. Les ordinateurs ont sûrement accéléré votre travail : il est possible, par exemple, d’effacer un mot ou une phrase sans être obligé de réécrire tout le texte. Mais il y a surtout le Web et ses atouts illimités. Quelle est ta relation avec le Net et dans quelle mesure est-il une richesse pour ton travail ?
J’ai si souvent recours aux outils que le Net met à notre disposition (comme la très grande majorité de mes consœurs et confrères) que je n’arrive même plus à concevoir qu’à une époque encore toute récente (moins de vingt ans), on travaillait autrement. Certaines recherches, qu’on peut faire maintenant en quelques minutes depuis chez soi, prenaient un temps fou, quand il fallait se rendre dans des bibliothèques etc. Sans aucun doute, le Net est une richesse, on y trouve des dictionnaires de référence, unilingues et bilingues, des dictionnaires spécialisés, des glossaires, des échantillons de toutes sortes de textes… et bien sûr des traductions. Et en plus, pour compléter ce que je disais en réponse à la question précédente, Internet permet aussi de voyager : on y trouve des photos, des vidéos, des cartes, des plans, des récits de voyage sur à peu près tous les endroits du monde, je pense… Et même plus : si un roman parle d’une rue dans une ville quelconque, que sais-je, mettons le Viale XX Settembre à Trieste, et s’il me paraît important, aux fins de ma traduction, de savoir à quoi ça ressemble, je peux parcourir cette rue virtuellement en quelques clics…
Je voudrais terminer cette rencontre par deux questions un peu plus personnelles.
Tu as remarquablement traduit en français certains des plus grands auteurs italiens, de Moravia à Ascanio Celestini en passant par Pier Paolo Pasolini et Dino Campana. Comment rester soi-même après avoir plongé dans des œuvres si complexes et fusionné avec des âmes si tourmentées et en mal de vivre ?
Il suffit d’être bien tourmenté soi-même, comme ça, quand on traduit des œuvres tourmentées, on n’est jamais dépaysé, on se sent tout de suite chez soi… Bon, ma réponse est (au moins en partie) une plaisanterie. Plus sérieusement : quand qu’on lit un livre – en tout cas quand on l’aime autant que j’aime ce qu’on écrit Pasolini, Celestini, Campana et d’autres – on est non seulement touché émotionnellement, on est aussi, plus en profondeur, affecté, troublé (comme l’eau se trouble quand on l’agite), et même modifié, je pense. On ne voit plus le monde exactement de la même façon après avoir lu un grand livre. Or, traduire un livre, c’est le lire à la puissance 10 ou 20. Si on lit une page en 5 minutes, on peut en revanche mettre une heure et demie, deux heures, trois heures ou plus à la traduire. Donc, comme lecteur, si on met cinq heures à lire un livre donné, si on doit le traduire on va vivre en sa compagnie, en sa présence, pendant des centaines d’heures. On va être habité par ce livre, par la voix de ce livre, tout le temps que durera la traduction, et souvent même avant, quand on l’a déjà lu et qu’on sait qu’on va ensuite le traduire, et même après, quand on a terminé mais qu’on continue d’y penser, parce que ça nous a habités, hantés, pendant des semaines et des mois. Et donc, pour répondre à ta question : on ne reste pas soi-même après avoir traduit, on devient quelqu’un d’un peu différent à chaque livre qu’on traduit. Je crois même qu’il y a des livres que j’ai voulu traduire parce que je savais qu’ils m’aideraient à… comment dire ?… changer, avancer, quelque chose comme ça. Comprendre mieux le monde, la vie…
Christophe Mileschi n’est pas seulement un grand traducteur, mais un homme de Culture : il est aussi un auteur de romans, de récits et de recueils poétiques ainsi qu’un artiste : il pratique la musique et le théâtre.
Tout le monde parle de culture, que ce soit en politique, dans les écoles ou à travers les médias. Définie comme un moteur incontournable pour apporter plus de justice sociale, elle est pourtant constamment en danger, comme nous avons pu le constater au cours de cette crise sanitaire mondiale. Quelle est ton opinion d’après ton activité d’enseignant, ton rôle de père et tes relations avec les jeunes ?
Ça, c’est une question difficile, la plus difficile de toutes. C’est vrai qu’on parle beaucoup de culture. Mais je ne suis pas certain que tout le monde parle de la même chose en disant « culture ». Les gouvernants, les médias, les responsables des programmes scolaires ont souvent de la culture une vision étriquée, d’une part, et orientée idéologiquement, d’autre part. Pour simplifier : on n’étudie pas beaucoup Gramsci ou Pasolini à l’école, on en parle moins souvent dans les médias que du dernier tube de tel chanteur à la mode, et globalement les hommes politiques ne s’en inspirent guère (c’est un euphémisme). Je soupçonne d’ailleurs que la plupart ne lisent pas ou plus…
Que la culture puisse être un moteur de justice sociale, peut-être, mais pas forcément. Sinon, les gens cultivés seraient tous des adeptes du progrès social, de l’émancipation des subalternes, de l’abolition des privilèges exorbitants dont jouissent certaines castes. Il est assez facile de constater que ce n’est pas – pas du tout – le cas. On peut même craindre, avec George Steiner par exemple, qu’il y ait un risque que la « grande » culture produise parfois des monstres. En tout cas, la culture n’est hélas pas incompatible avec la violence sociale, avec l’injustice, avec la perpétuation des rapports de domination et d’exploitation de certaines classes sur d’autres. On peut connaître Mozart par cœur, avoir étudié Homère pendant trente ans, être expert de latin et de grec ancien, et prôner la chasse aux migrants, ou être au mieux indifférent à leur sort. Plutôt que de parler de culture sans dire de quoi on parle, il faudrait peut-être parler de culture critique, entendue comme une sorte d’outillage qui permet d’interroger les évidences, de résister à la puissance d’endoctrinement permanent des grands médias, des discours convenus. Comme enseignant, c’est ce que j’essaye de faire avec les étudiants, : les inciter à se cultiver, bien sûr, mais en gardant toujours un œil critique sur ce qu’on leur propose ici et là comme « culture ». La culture n’est jamais neutre.
En ce sens, la culture n’est pas en danger : ce qui est en danger, ce sont certains territoires et certains aspects de la culture, par exemple des langues vivantes dont l’enseignement est menacé par les réformes scolaires et par l’expansion du globish, cet anglais de 300 mots dont on voudrait croire, évidemment à tort, qu’il permet de tout dire… D’une certaine manière, les traducteurs, même s’ils ne le font pas délibérément, s’efforcent de garder vivante la conscience d’une multiplicité des langues, et donc des mondes que les langues portent, c’est-à-dire, en somme, la conscience de la complexité et de l’étendue, à l’échelle de l’humanité tout entière, pas seulement à l’échelle de quelques décideurs et faiseurs d’opinion, de ce qu’on peut appeler culture.
Interview réalisée par Stefania Graziano