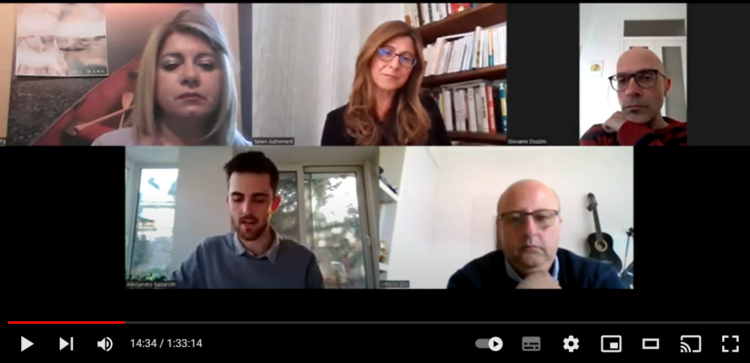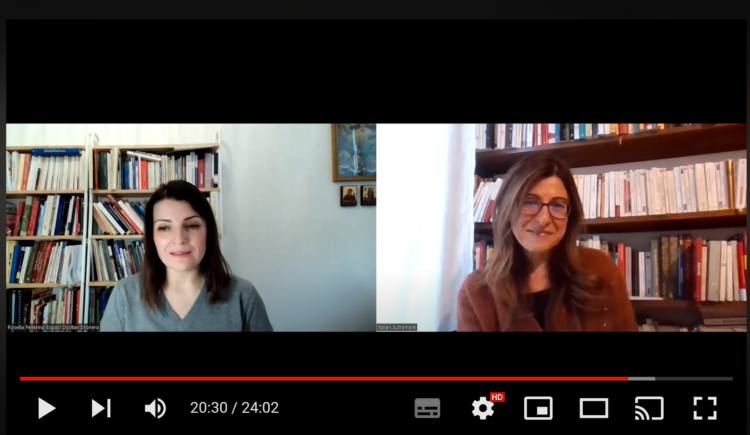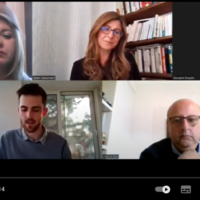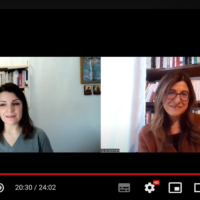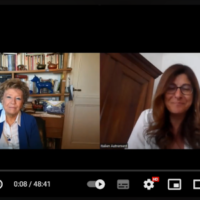Pianiste jazz imprégné de musique classique, Stefano Battaglia a participé à plus de 3000 concerts en Italie et dans le monde entier. Il a publié de nombreux disques et reçu des prix prestigieux nationaux et internationaux. Il enseigne aux séminaires de l’École Siena Jazz et dirige le Laboratoire Permanent de Recherche Musicale consacré aux disciplines de l’improvisation, de la composition et de l’expérimentation. Actuellement, à côté de l’intense activité de soliste, il développe de nouveaux projets en collaboration avec des artistes de la scène musicale italienne.
En concert à Bordeaux, à l’occasion du 100e anniversaire de la naissance de Pier Paolo Pasolini, il a accordé à notre revue une longue interview que nous avons le plaisir de vous proposer.
J’ai lu, dans une interview, que tu es né dans une famille d’artistes. Ta grand-mère était pianiste. Qu’est-ce que cela a signifié pour toi et pour ta formation musicale ?
Je ne dirais pas vraiment que je viens d’une famille d’artistes. En réalité, ma grand-mère était la « mouche blanche » de la famille et je le suis devenu, moi aussi, après elle, par…émanation. Concertiste, elle a été ma première enseignante de piano entre 1972 et 1983, à une période de la vie où il est important que la musique soit magie et jeu en plus d’une discipline rigoureuse. Pour permettre à l’individu de se révéler, elle doit sans aucun doute prendre en partie la place du jeu, de la découverte, du dévoilement. C’est la seule façon pour atteindre l’équilibre. C’est la seule façon pour permettre à un enfant d’être joyeusement concentré dans une discipline. L’enfant doit se sentir immergé dans un mystère plein de beauté. Pour moi, cela a été une « bulle magique » dans laquelle j’ai pu grandir probablement aussi de façon un peu auto-protectrice. A cet âge-là la musique peut être aussi une mère-nid ; le son peut être un refuge plein de charme, la continuation de la vie utérine. La différence avec la leçon classique de piano a déterminé cet enchantement : la leçon se terminait, ma grand-mère se levait et reprenait sa vie habituelle à la maison tandis que je restais pendant des heures au piano sans avoir aucune idée de ce que j’étais en train de jouer. Aucun autre maitre donne autant de liberté à ses élèves et encore moins dans sa maison et avec son piano. Dans mon cas, l’affection de ma grand-mère a joué en ma faveur. Elle pensait peut-être que j’étais un peu fou ; une fois le sujet de la leçon épuisé, elle me donnait l’opportunité de m’ouvrir à la musique, en encourageant, sans aucun jugement professoral, ma créativité. Elle m’a donné cette confiance qui aux cours des années s’est révélée précieuse car l’expressivité, si elle n’est pas vécue de façon naturelle et spontanée, est une conquête compliquée surtout quand elle devient aussi un métier. Sentir la compréhension d’une personne compétente (elle n’était pas seulement une bonne enseignante ; elle était aussi une bonne pianiste avec une discrète activité de concertiste) est primordial pour un enfant et un adolescent. Cela lui donne la détermination et la confiance en ses propres moyens, qualités nécessaires pour surmonter les aspects les moins poétiques de la dimension professionnelle : la confrontation, la compétition et le consensus. Je dois donc à ma grand-mère, bien qu’elle ait été exclusivement une interprète, mon centrage spontané autour de la créativité et l’équilibre que j’ai réussi à protéger par rapport à ce qui est en dehors de la bulle magique. Au fond, il en est encore ainsi. Bien que je joue souvent pour les autres, la musique reste mon maitre, mon centre, mon phare, mon guide. C’est comme une relation profonde et perceptive, typique des relations qui se construisent justement pendant l’enfance. Ce que l’on peut définir l’instinct conscient.
Depuis quelques décennies, on parle beaucoup d’improvisation. De nouveaux mots ont été inventés et on rencontre de plus en plus de musiciens qui la pratiquent, non seulement dans le jazz mais aussi dans d’autres genres musicaux. Cependant l’art de l’improvisation a toujours existé et tu le sais très bien puisque tu as commencé ta carrière en jouant du baroque avant de t’approcher de la musique moderne. A quel point est-ce important de se confronter aux autres dans la pratique de cette discipline ?
C’est un geste primitif qui a toujours existé. Tu connais ma passion pour la musique baroque : eh bien, à l’époque tous les musiciens improvisaient. Leur virtuosité était souvent basée sur la capacité d’inventer des rythmes, des phrasés, des modulations, d’explorer l’art de la variation. Bien évidemment depuis l’arrivée des Académies, ceci est devenu aussi un métier et tout a changé. Au cours des siècles, la spécialisation, le rituel du concert, les répertoires et même les responsabilités de garder vive la mémoire d’une civilisation entière à travers une zone privilégiée de sa culture, ont eu le dessus sur le ici et maintenant et sur l’urgence expressive. Pour ne pas parler du disque qui a même cristallisé et rendu éternel un geste qui, jusqu’à la fin du XIX siècle, vivait seulement du « Ici et maintenant » évoqué plus haut. Ce qui m’intéresse dans la musique c’est son atemporalité ; son sens profond n’a pas changé et je me bats afin que ce soit toujours ainsi : il doit être à nouveau un geste d’une grande puissance significative et profonde mais simple et spontanée. Le « moi performer » qui se relie à l’autre à travers une langue qui est potentiellement universelle, perceptive, métalinguistique.
On comprend la langue de la musique même sans la saisir ; pour cette raison, elle est plus vraie et plus intime que celle liée à la parole, à la connaissance idiomatique spécifique. C’est l’amour dans un sens archétypal, de synthèse : quand on aime, la force et la pureté du geste amoureux, des sens et de la perception deviennent un langage universel qui peut relier de façon profonde des êtres de n’importe quel lieu de la planète : l’improvisation musicale donne aux musiciens la grande occasion de n’appartenir à aucune langue et par conséquent à toutes les langues. Du moins de temps à autre, car il n’est pas nécessaire qu’elle fasse partie de la profession. Tout le monde ne naît pas avec les caractéristiques du « performer ». La musique est une. Le fait qu’un jeune coréen d’aujourd’hui puisse écouter Bach et comprendre notre civilisation- bien qu’à un autre niveau – mieux qu’à travers n’importe quelle leçon d’histoire en italien, c’est une magie incomparable ! De même, un musicien africain peut dialoguer avec un collègue mongol en renonçant à une partie de son appartenance, en improvisant à travers une conscience a-idiomatique que seulement l’expérience et l’usage de l’improvisation donnent. Un vrai miracle !
L’erreur est de vouloir enseigner la musique à l’instar d’un langage, comme si elle était composée seulement de grammaire et de syntaxe. En agissant ainsi, se créent des « tribus » qui n’ont pas la possibilité de communiquer entre elles. Et alors les baroques communiquent seulement avec les baroques, les boppers avec les boppers, les punks avec les punks etc. L’improvisation doit être récupérée dans toutes les académies pour recréer ou défendre un espace neutre égal pour tous et où tous peuvent parler sûrs d’être compris, quelle que soit leur communauté musicale d’origine. Chacun de nous appartient à un langage selon la culture d’où il provient et dans laquelle il a vécu, a étudié et, dans certains cas, s’est construit : puis, nous avons aussi un potentiel oltre : l’esperanto de l’improvisation.
Tu as développé non seulement une importante activité de soliste, mais tu as toujours donné beaucoup de place à des projets de collaboration avec d’autres musiciens. Je pense notamment à celui très touchant que tu as dédié aux poètes frioulans avec la vocaliste Elsa Martin. Que signifie pour toi partager la musique ? Est-ce le sentiment d’appartenir à une communauté ?
Absolument. C’est exactement cela. Appartenance à la musique et création de communautés musicales saines, créatives, autonomes, responsables où le talent est protégé de la recherche du consensus, de l’idée que le succès dépend de la quantité de public ou de la rétribution que l’on perçoit. L’ambition doit toujours être celle de jouer de la bonne musique, de laisser des richesses sur la planète comme trace de notre passage souvent en contradiction avec le succès que je viens de décrire et la façon dont il est malheureusement souvent compris.
 Foto Luca A.Agostino
Foto Luca A.Agostino
Tu as dédié certains de tes travaux à des personnages illustres. Je suis bouleversée chaque fois que j’écoute Re :Pasolini. Un album d’une grande richesse musicale, linguistique et poétique. A travers la musique, tu as réussi à faire revivre la personnalité complexe et controversée d’une des plus importantes figures du XX siècle. Un poète visionnaire qui avait compris que le progrès effréné était responsable d’un appauvrissement linguistique et de la disparition de certaines langues et de certains dialectes. Que peut faire la musique pour éviter que tout cela n’arrive ?
L’art sous toutes ses formes devrait avoir un rôle central, mais seulement à condition qu’il ne devienne pas une monoculture. Cette pensée a été une des illuminations de Pasolini anthropologue, le sens de son Canzoniere italien : une anthologie monumentale de la poésie populaire devenue avec le temps une ode aux traditions de la langue italienne. Il a esquissé la genèse des chants régionaux à travers presque huit cents textes de genres et de structures différents, des villotte vénitiens et frioulans auxquels il appartenait aux biojghe romagnoles, des rispetti toscans aux canzuni des Abruzzes, des chants funèbres calabrais aux mutos sardes en passant par des couplets, des strambotto, des berceuses, jusqu’aux chants de guerre et aux chansons fascistes et partisanes en analysant intensément la koinè de la nouvelle langue contaminée. Le Canzoniere a été et continue d’être un portrait très vif, poétique et critique d’un peuple et de ses racines. Je lui ai consacré un morceau, Canto popolare que, en cette période de célébration du 100e anniversaire de la naissance de Pasolini, j’ai repris avec grande joie.
Voici le sens de ma collaboration avec une voix, celle d’Elsa Martin, qui choisit de s’exprimer dans une langue romance de souche ladine. L’art doit représenter l’autre plateau de la balance, être le métalangage qui permet une compréhension complétement différente, plus élevée et plus profonde, plus intime et plus vraie, capable de mettre en relation un allemand avec un habitant de Tuva, un africain et un japonais et ceci est d’autant plus important aujourd’hui que l’anglais est devenue la monolingue du monde entier. Parmi toutes les formes d’art, la musique est probablement celle qui a le plus d’instruments perceptifs extra-intellectuels (elle ne donne pas à voir, toucher, savourer ; elle travaille exclusivement dans le subconscient, dans l’imagination, dans l’ineffable, dans le mystère du phantasme aristotélique ou dans la phantasia qui en découle) parce que le son et le rythme ont des capacités spatio-temporelles révélatrices et universelles : ils traversent lieux et temps, géographies et épiphanies.

Il est impossible de parler ici de tous tes albums mais je voudrais m’arrêter un instant sur Pelagos, un magnifique double album sorti en 2017 pour ECM où tu racontes le voyage de ceux qui émigrent vers des pays meilleurs en emportant avec eux la douleur de l’exil. Il me semble que ta musique est un peu comme la mer où des cultures et des peuples différents se fondent dans un hymne à la vie. M’accordes-tu cette expression ?
Je te remercie infiniment. Quand ma musique transmet cela, je me sens complétement compris : mon héritage méditerranéen est très profond. Naître en Italie ou en Turquie, en Grèce ou en Israël, en Syrie ou en Espagne, au Liban ou au Maroc, en Palestine ou en Slovénie, en France ou en Albanie, en Egypte, en Tunisie, en Croatie doit forcément apporter un héritage, une « legacy » si l’on veut utiliser un mot anglais plus international. Notre destin est différent selon l’endroit où l’on naît. Le « Mare Nostrum » est une ressource très précieuse dans son indescriptible complexité, sa richesse et son histoire. C’est un héritage d’échange de dons mais aussi de luttes ensanglantées, de grandes civilisations et de misère, de richesse et de pauvreté, d’osmoses culturelles et de conquêtes sanglantes : c’est une mine inépuisable de beauté mais aussi un tombeau. C’est le récit de mariages vertueux mais aussi de séparations douloureuses. Sa morphologie inspire toujours communication et fermeture, mélanges fascinants de civilisations mais aussi sens de la limite. Et ceci est d’autant plus vrai pour ceux qui y naissent, qui y grandissent, qui y étudient, qui lisent, qui écoutent, qui respirent, qui mangent, qui boivent, qui voyagent. Pelagos voudrait raconter tout ceci dans l’espoir idéal qu’il existe pour l’homme ne serait-ce qu’une seule possibilité d’évoluer. Que finalement cessent l’idée de con-fins et les gestes insupportables de refus et de rejet qui en découlent dans un sens de séparation odieuse et qu’on s’abandonne aux grands mouvements anthropologiques comme occasion de richesse et de transformation vertueuse à travers les principes de coexistence et de compassion, d’acceptation et de solidarité, simples lois de l’humanité qui, hélas, ne semblent plus appartenir à notre nature.
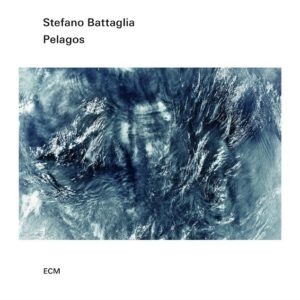
Tu es non seulement un grand compositeur, mais tu trouves aussi le temps pour enseigner la technique de l’improvisation à l’école Siena Jazz et poursuis le projet Tabula Rasa à l’Académie Chigiana. J’ai l’impression qu’aujourd’hui les jeunes sont jugés un peu superficiels, éloignés de la réalité et parfois aussi égoïstes. Quelle opinion t’es-tu faite en passant beaucoup de temps avec eux ? Qu’apportent les jeunes à un enseignant cultivé et curieux comme toi ?
L’égoïsme est structurel dans beaucoup de civilisations individualistes. Une large part de la civilisation occidentale est hélas structurellement anthropocentrique et, depuis toujours, il existe un grand courant de pensée qui met l’homme au centre de l’univers. Aujourd’hui à cause du désastre environnemental dû d’abord à l’industrialisation, puis à la globalisation, règne le principe -même dans les écoles- qu’il faut sauver la planète, comme si elle avait vraiment besoin de nous pour survivre alors qu’il est évident que nous ne parlons que de notre propre survie, que de notre propre extinction. La planète est, pour ainsi dire, une conscience bien plus ancienne et évoluée que la nôtre et, comme son petit habitant bêtement égocentrique ne se comporte pas bien, après de nombreux avertissements elle l’expulse à travers ses systèmes de renaissance infinis (nous l’avons vu récemment avec un virus invisible, mais aussi avec les changements climatiques, les éruptions et les désertifications, la sècheresse et les incendies, les glaciations et les tremblements de terre, les bactéries et les tsunamis). Nous avons eu beaucoup de preuves tangibles de la renaissance : même Tchernobyl ressemble à un étrange Eden aujourd’hui. Il a suffi d’éloigner l’homme de ce lieu pendant moins de 50 ans… Et pourtant le principe qu’il faut « sauver la planète » continue d’être fort. Il attendrit presque, n’est-ce pas ? Pour les jeunes – et non seulement – c’est une époque très complexe avec une quantité d’informations pathologiquement excessive. Il y a tellement de stimulations de tous ordres – des sublimes à d’autres extrêmement bas, parfois même dégradants – que paradoxalement ils n’arrivent plus à réagir, ensevelis par d’autres stimulations. En philosophie tout et rien sont la même chose. Le résultat est l’apathie anesthésique, une réaction qui est indifférente à l’excès. Nous vivons dans une civilisation qui pendant des siècles a poursuivi de façon déterminée une certaine idée de bienêtre et qui de façon directement proportionnelle, semble s’être éloignée de façon évidente de l’essentiel en remplissant les vides, quand tout va bien, avec la substance des autres et donc la projection de soi et quand tout va mal avec d’autres vides. Le bienêtre est seulement en puissance une petite pièce de la mosaïque. Cette révélation, bien évidemment, ne date pas d’aujourd’hui et pourtant un changement de cap semble impossible. Cette consommation excessive et toutes les possibilités qui nous sont offertes sont un malheur pour l’urgence expressive, pour le pathos, pour le temps (qui ne suffit jamais car il est rempli de trop de choses souvent inutiles) : aussi bien pour le Temps-Chronos comme quantité, unité de mesure, que pour le Temps-Kairos comme qualité du temps, c’est-à-dire la façon dont il est rempli. Vaut-il mieux regarder un concert sur le net gratuitement en restant dans fauteuil ou bien voyager jusqu’à Istanbul et se payer un concert au théâtre en participant à l’énergie du rituel collectif, en ressentant l’électricité psycho-physique du ou des « performers » ? Vaut-il mieux regarder du Caravage à la télévision ou se perdre devant un tableau dans un musée où l’on peut percevoir le travail de chaque coup de pinceau ? Et mettre soi-même les mains dans la couleur ? Vaut-il mieux regarder quelqu’un qui cuisine dans une compétition ou bien mettre les mains à la pâte ? Vaut-il mieux regarder un chef qui teste des plats dans une émission télévisée ou bien aller à Tunis manger un couscous ? Vaut-il mieux aimer réellement un autre corps ou laisser que les autres le fassent en s’identifiant aux protagonistes ? Et même si nous n’avons pas les ressources pour être protagonistes, était-ce mieux de rêver être au concert, de manger le couscous à Tunis, de rentrer dans un musée ou bien de regarder tout cela dans un écran vidé de l’aura unique des choses réellement observées? Et pourtant toutes ces « pertes de temps » qui ressemblent évidemment à une tragédie individuelle sont devenues une substance normale qui drogue les identités : l’être se révèle en agissant de façon active et dynamique. L’expérience totalisante veut que tous les « centres » (corps, âme et esprit) et que tous les sens soient présents et éveillés là où les choses se passent. Cela permet d’avoir ensuite, éventuellement, « quelque chose à dire ». Le système perceptif veut que tous les sens soient actifs et la parole sens nous montre combien il est lié au sens de la vie. Voici ce que les jeunes me demandent de façon subliminale et le plus souvent de façon inconsciente : existe-il la possibilité de passer l’existence dans la beauté et dans l’expression de soi ? La musique représente-elle cette possibilité ? Certainement. Pour moi elle l’a été et j’espère pouvoir leur transmettre ce privilège. Comment faut-il faire ? Travaillons-y.
Aujourd’hui la musique est accessible à tous : on peut l’écouter partout et la télécharger gratuitement. Il y aurait donc de quoi se réjouir. Et pourtant cette démocratisation excessive (si tu me passes le terme) me fait peur. Sortir pour aller à un concert, pour aller au cinéma sont des rituels qu’il ne faudrait pas perdre. Qu’en penses-tu ?
Je suis d’accord. Pour les simples consommateurs le net et la gratuité sont une manne. Pour un artiste c’est une vraie tragédie. Et je ne parle pas seulement des droits, de la reproduction ou du soutien économique qui sont des arguments qui viennent dans un deuxième temps, mais de la protection des caractéristiques de vérité et de sens qui sont indissolublement liées à l’identité, à l’individu (littéralement : qui ne peut pas se diviser). Au moment où il se dirige consciemment vers le consensus il commet déjà, le plus souvent, un sacrilège envers lui-même. Cela vient de la facilité avec laquelle tous sont en contact avec tout et peuvent s’éloigner d’eux-mêmes continuellement, en s’identifiant à un autre, perdant ainsi leur unicité propre. Comme je l’ai dit plus haut, tout est animé par le désir. Sans ce carburant tout semble vide. La consommation tue le désir. Si tu écoutes de la musique gratuitement toute la journée, il est peu probable que tu aies envie de sortir le soir et de dépenser pour écouter un concert. Le silence est la prémisse de la musique, elle en a un besoin existentiel par complémentarité. Si nous étions nourris gratuitement toute la journée, qui dépenserait un euro pour aller au restaurant le soir ? Il manque aussi bien l’appétit qui est complétement déprécié par l’absence de discontinuité, que l’opportunité d’investir des ressources pour une pratique déjà consommée plus au moins passivement au cours de la journée. La musique est elle aussi une nourriture : si elle est absorbée toute la journée, le plus souvent de façon passive (dans les bars, les restaurants, les aéroports, les ascenseurs, les moyens de transports, les téléphones, les ordinateurs), le désir de jouir de sa ritualité (la salle avec une bonne acoustique, le silence qui entoure l’évènement) se réduit au minimum. De la même façon se réduisent au minimum les capacités individuelles d’écouter les sons et les merveilles infinies de leurs détails pour ceux qui ne se protègent pas et « dévorent » toute sorte de musique au cours de la journée à travers des sources de reproduction inadéquates (surtout téléphones et ordinateurs). Je prends toujours comme exemple la pornographie, un peu brutale mais significative : peut-on imaginer le désir d’aimer l’autre à travers l’instrument du sexe (qui exige la présence du corps et de l’esprit) après avoir perdu son temps – peut-être même toute la journée – cela est gratuit à regarder les autres agir (avec leur propre individualité) ? Pour celui qui fait de la musique c’est la même chose : vivre passivement le son pendant des heures (non seulement la musique mais aussi les bruits) signifie éroder inexorablement- et plus au moins consciencieusement- le désir du son et donc de musique – et la capacité d’en goûter les contenus avec toutes les possibilités du système perceptif individuel. La perte de sensibilité du système perceptif est certainement une perte collective de civilisation mais, comme toujours, il existe une communauté d’individus lucides, conscients et passionnés qui résiste et réagit avec une force qui me semble directement proportionnelle aux dérives de la consommation dont je viens de parler. Dans une dimension presque tribale et marginale qui ressemble à un rempart, il faut bien le dire.
Interview Stefania Graziano
Site de Stefano Battaglia https://www.stefanobattaglia.com
Pelagos : Suite + improvisation (2017) https://www.youtube.com/watch?v=GBtN73It-dQ