Le jour où je suis né, on m’a parlé en dialecte. Il y a eu, d’abord, le trentin. La langue de la maison. La langue d’une toute petite terre, le Trentino, et plus exactement de la ville de Trento. Car, dans le Trentino, les habitants d’un village reconnaissent les furesti, étrangers du village voisin, sur la base d’une voyelle ouverte, d’une désinence prononcée de façon insolite. Mon père était le seul à parler le « vrai » dialecte, car nous parlions, et cela venait du côté de ma mère, un dialecte tacheté d’italien. Un dialecte hybride, bâtard. Le verbe manger, par exemple, devenait mangiar, ce qui n’était ni l’italien mangiare ni le dialecte magnar.
Il y a eu, d’abord, le trentin des ancêtres éleveurs et agriculteurs. Parole d’un quotidien dur, sur un sol ingrat. Langue à la fois riche et pauvre. Pauvre, car elle ne connaît pas les mots de la philosophie, de l’abstraction ; c’est d’ailleurs une langue éminemment orale. Face à la puissance de la langue italienne, riche de siècles de littérature et d’échanges intellectuels, le trentin se met en retrait. Les paysans ont peur de la langue italienne avec ce qu’elle représente : l’institution, la culture en tant qu’élite. Et le trentin n’est pas le venexian, langue de la Sérénissime qui eut ses poètes et ses intellectuels couronnés par l’histoire.
La richesse de mon dialecte se révèle dans les mots ordinaires, qui nomment les objets utiles à la campagne et à la maison. Dans cet univers, le dialecte est souverain. Le récit de son enfance pendant la guerre, mon grand-père nous l’a transmis en trentin ; il n’y a que sa voix, son timbre doux mais empreint d’une gravitas avec laquelle il scande les mots, pour le raconter. Lever à cinq heures du matin, la mama ouvrait les volets en bois laissant entrer le froid dans sa chambre. « Fabio, va’ per acqua » elle susurrait, « Fabio, va chercher l’eau ». Sa mère, la nonna Elisa, à genoux, priait pour qu’un de ses enfants revienne de la guerre. Ils n’avaient aucune nouvelle. Et il revint, un jour, d’un camp de prisonniers allemand, squelette sur le char du laitier. Pendant trois ans, chaque soir, sans exception, l’enfant qu’était mon grand-père était allé voir si, sur le char du laitier qui remontait jusqu’au village, il y avait zio Clemente. Un soir de mai, c’était lui, sur le char, avec une valise en carton.
Les récits de mon grand-père disparaissent comme disparaît la langue qui les raconte. Le dialecte meurt avec les hommes et les femmes qui lui confiaient leurs jours, leurs sentiments, leurs rêves. Les mots des pauvres ne survivent que dans les dictionnaires des linguistes locaux, momifiés sur des tableaux statistiques selon la localisation dans la vallée. Le dialecte meurt, et c’est aussi car, après la télévision et internet, il suffit de peu pour se faire traiter de paysans : parler italien est une valeur sûre. La stigmatisation fait des ravages et les laudatores des langues régionales brandissent trop souvent les étendards de la pensée réactionnaire.
Pendant de longues années, j’ai tourné le dos au dialecte. A travers la langue italienne, à l’école, je découvrais de vastes étendues de savoirs qui semblaient inconnus à la langue des montagnes. S’aventurer dans les zones d’ombres de l’âme humaine, découvrir l’altérité, c’était un voyage qu’à mes yeux seule la langue italienne rendait possible. Et le dialecte devenait insupportable. Mon père, amoureux des langues, avait beau prendre sa défense, je détestais cette langue qui me tenait prisonnier d’un monde devenu trop petit, trop étroit. Peut-être avais-je perçu, sans pouvoir la nommer, une menace à laquelle s’exposent les langues minoritaires : le spectre du clan, comme refuge imperméable aux tremblements psychiques que tout étranger provoque avec sa différence. Réaction de défense contre la stigmatisation par la culture élitiste, probablement. Aux yeux de l’adolescent que j’étais, les locuteurs de cette petite langue ne faisaient qu’un avec ceux du patriarcat et de la messe du dimanche, qui méprisaient les immigrés. Ils n’avaient pas la finesse des conférenciers qui intervenaient en italien, au lycée, dont m’enthousiasmaient les adjectifs colorés, les périodes bien construites, galaxies lumineuses dans l’univers de l’histoire des idées. L’italien était un immense ciel étoilé. Il était le pont vers l’Europe et le monde ; ses piliers étaient les traductions de nos anthologies. Dans mon imaginaire, le dialecte, figé dans les croyances, la superstition, la peur de l’autre, avait perdu.
J’ai eu terriblement peur du lien qui me liait à la terre. Peur qu’il me dévore, qu’il absorbe mon âme dans ses sables mouvants. Je me sentais seul, dans ma terre. Peut-être déjà étranger, en fin de compte. Maintenant, je suis libre. Ma thérapie a été l’exil, l’oubli ; comme un phénix, je suis né des cendres de mon enfance, sur un nouveau sol qui m’a accueilli. Mais la blessure ne cicatrise jamais définitivement. Les immigrés sont des êtres fracturés. Parfois, à des moments inattendus, revient la douceur nostalgique des paroles de mon grand-père. Sur les réseaux sociaux, niché dans une page consacrée aux études régionales, j’ai découvert un poème écrit dans mon dialecte. Et j’ai eu pitié pour la dureté de mes sentiments. Sa terre natale, on peut la renier, on peut la dénigrer, on peut se l’arracher. Elle revient, patiente. La terre ne nous oublie pas. Je suis devenu autre par rapport à cette terre. Je n’ai plus peur qu’elle m’étouffe. Aujourd’hui, je vais peut-être commencer à la comprendre. Et à l’aimer.
Bruno Rattini


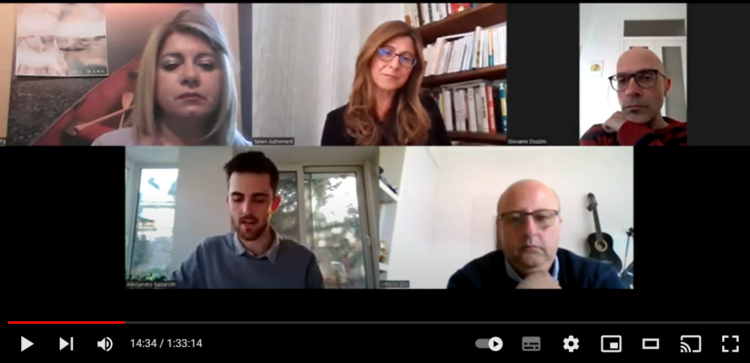

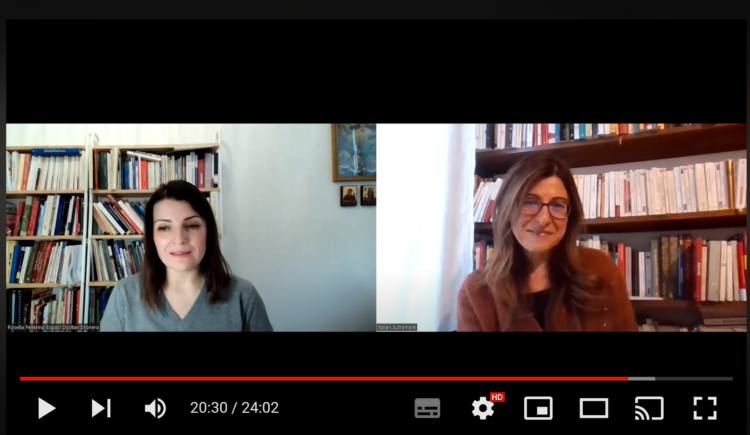
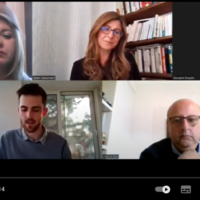

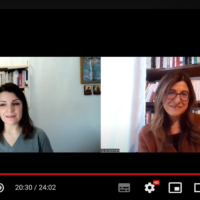

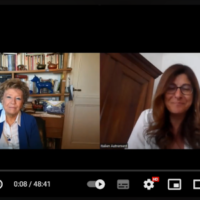








Comments
Muriel Garaicoechea
Quel plaisir de lire cet article si bien écrit et avec une réflexion qui a tant de parallèles avec les langues que je chante (basque, […] Read MoreQuel plaisir de lire cet article si bien écrit et avec une réflexion qui a tant de parallèles avec les langues que je chante (basque, occitan) mais que je ne comprends pas. Une langue, c'est une affection retrouvée, et je n'entendrai plus les inflexions de voix de ma grand-mère béarnaise qui m'a élevée bébé. A quand une collecte des musiques et paroles du Trentino? Read Less
Renato C.
Bravo. C'est finalement la reconquise de ton identité. Si è italiani tutta la vita !