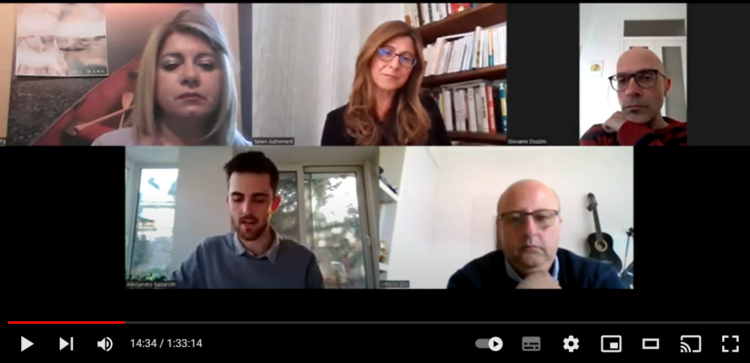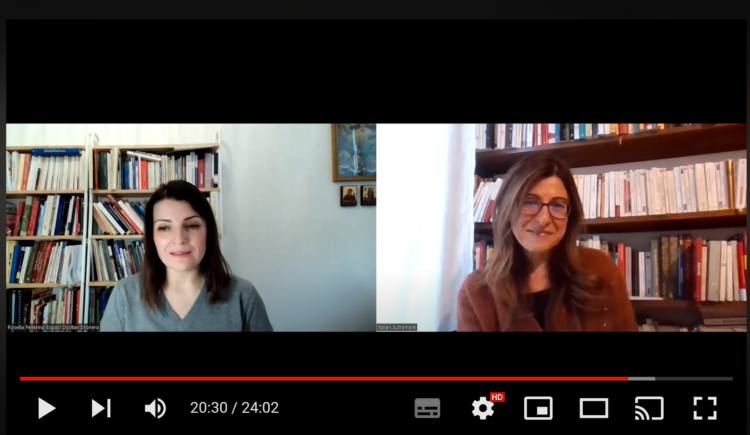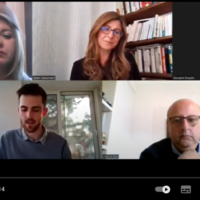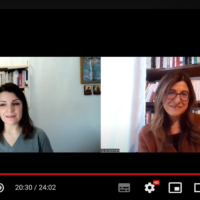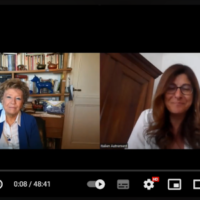Du Gloria de la Missa Luba qui ouvre l’Évangile selon saint Matthieu aux harmonies lointaines du chant frioulan Stelutis alpinis hantant le dernier supplice de Salò ou les 120 journée de Sodome, la musique (et particulièrement celle dite « classique ») traverse l’œuvre de Pasolini. Loin d’être un simple ornement, elle bouleverse les images, problématise leur interprétation par des juxtapositions audacieuses, par une mise en profondeur puissante employée par le cinéaste tout au long de sa carrière.
Âgé de vingt-deux ans à peine, le jeune Pasolini, violoniste amateur passionné par Bach, avait un projet : réaliser une étude sur la musique du cantor, intitulée Studi sullo stile di Bach. Un court fragment, écrit entre 1944 et 1945 (inédit jusqu’à 1999), est le seul témoignage de ce travail singulier de jeunesse : Pasolini abandonna le projet et se prononcera rarement, au cours de sa vie, sur la musique, qu’il abordera surtout en tant que musique appliquée. Il ne faut pas chercher dans les Studi sullo stile di Bach la rigueur de l’analyse musicologique ; mais cette étude mérite une attention particulière. Par son élan qui le pousse, presque irrésistiblement, à représenter, à peindre Bach, Pasolini interroge la manière dont on peut parler la musique : dans quelle mesure est-il possible, voire légitime, de donner un contenu représentatif au langage musical ?
Pasolini se lance dans une caractérisation expressionniste et passionnée de la Siciliana pour violon seul (le lien pour l’écouter se trouve en bas de page). Laissons-nous guider par sa lecture des deux premières mesures. Les sept notes du début (première incise), graves, ont « une intonation de voix humaine, mieux, un coloris de voix adolescente. Elles ont la douceur d’une parole amoureuse qui retient la chaleur de la poitrine d’où elle sort ». Les notes incarnent un désir : « j’imagine la voix sortir d’un jeune corps, avec une expression assez arcane des yeux et de la bouche. Un état amoureux (amorosità) en tant que pur état amoureux ; sans objet d’amour, presque hermaphrodite ». Les notes qui suivent (deuxième incise), jouées par les cordes aiguës du violon, forment un contraste manifeste avec celles qui les précédaient. Pasolini y perçoit un son « naturellement cru et étroit sans attraits ni douceurs faciles » ; un son « argenté ou blanc, […] haut, c’est-à-dire vertical ». Deux mesures (environ dix secondes de musique) suffisent pour esquisser une lecture imagée de la Siciliana : « le contraste est parfait. D’un fragment de chant d’amour monodique, chaleureux, humain, sombre, nous voici comme par magie parmi les notes d’un chant sacré, choral, froid, surhumain, éthéré. Je vois ici un contraste de sentiments ». Pasolini explore ensuite la relation entre ces deux images antagonistes. Nous pouvons être surpris par l’aisance avec laquelle, à partir de voix musicales, il voit des images pouvant prendre la forme d’un corps amoureux. Comment ceci (les notes) veut dire cela (la bouche amoureuse) ? Avant de revenir à Pasolini, j’aimerais m’attarder sur cette question cruciale et inextricable qui a traversé toute l’histoire de la musique et qui est tout simplement celle-ci : que veut dire la musique ?
Une phrase musicale ne veut rien dire. Attention : ce dire correspond à des signifiés du langage verbal, à une représentativité. Si nous restons fidèles à la grammaire et à la syntaxe musicales (succession de notes, rythmes, hauteurs, intensités, timbres), nous ne trouvons bien évidemment aucune trace des images pasoliniennes. Car la musique, et surtout celle dite « pure », qui existe sans le support d’un texte (comme c’est le cas pour cette Siciliana), s’exprime en tant qu’assemblage réfléchi de matériaux sonores par un langage qui se suffit à lui-même. Il est vrai qu’à l’époque de Bach il était courant d’illustrer un texte mis en musique par des « équivalences » musicales (une descente par demi-tons, par exemple, appelée passus duriusculus, était employée pour exprimer le deuil). Mais il s’agissait de musique vocale. La musique pure, dépourvue de texte, a dû résoudre le problème de la forme en se servant plus ou moins consciemment de techniques issues de la rhétorique classique ; ces techniques ont contribué à l’organisation de la matière sonore et à la construction d’un discours-de-sons doté d’une cohérence interne (Claude Abromont propose une lecture rhétorique du concerto brandebourgeois nº 3 – le lien est en bas de page). Pourquoi donc, même lorsque nous écoutons de la musique pure, nous pouvons non seulement ressentir des émotions – ce qui est déjà surprenant – mais également, en l’absence d’un texte, voir des images, rêver les yeux ouverts ? Il s’agit d’un système complexe de souvenirs et de codes culturels. Imaginons que j’aie entendu pour la première fois une aria de Bach dans l’Évangile de Pasolini : les scènes du film pourraient défiler sur mon écran intérieur à une prochaine écoute ; surpris par un roulement de timbales, je pourrais me figurer l’urgence d’une menace ou d’un événement solennel, car mon oreille y a été culturellement accoutumée par un répertoire allant de la Symphonie « Pastorale » de Beethoven aux films de Steven Spielberg (de la même manière qu’un auditeur averti de l’époque de Bach aurait pu ressentir le deuil en entendant un passus duriusculus). Il ne s’agit bien sûr ici que d’une simplification, mais qui montre, il me semble, la puissance de ce mécanisme d’attribution de significations extra-musicales : nous sommes prédisposés à ce genre d’associations. Se représenter le discours musical en même temps qu’il se déploie est une délicieuse et inéluctable tentation et pour parler la musique l’on recourt volontiers à des métaphores extra-musicales (Les sanglots longs / Des violons…). Dans la musique, comme dans la poésie, le sentiment est transformé en discours, dit Pasolini, « avec cette économie, cette mesure, cette affliction qui sont communes à toute œuvre d’art ». Musique et poésie sont sentiment mis en forme, à partir du silence. Il n’est pas étonnant que Pasolini tisse une comparaison entre la musique et la poésie de Mallarmé ou de Valéry (pour qui le poème est « cette hésitation prolongée entre le son et le sens »), auteurs qu’il considérait plus proches de la « musicalité de la musique ».
Si Pasolini traduit Bach en images, c’est parce qu’il croit à ce pouvoir représentatif de la musique. C’est en vertu de ce postulat qu’il peut s’abandonner à une lecture fascinante et intemporelle, qualifiée de « romantique » par certains lecteurs dérangés par la prolifération des images. Pasolini n’était pas musicologue (oserait-on le lui reprocher ?). Mais il est ici, à sa manière, poète des sons, comme avait pu l’être Albert Schweitzer, grand exégète de Bach (sauf que dans cette lecture pasolinienne, s’il est question de « sacré », Dieu n’apparaît pas pour autant). La relation entre musique et langage verbal demeure instable. Pasolini voyait l’impasse qui guette la critique musicale : dans le domaine musical, dit-il, « même la critique esthétique la plus expérimentée ne pourra jamais se libérer des paroles », car la musique « n’a pratiquement pas de contenu. Ou, si elle en a un, il se situe à l’intérieur de l’auditeur ». Si le langage musical, intraduisible selon Lévi-Strauss, semble être totalement libre de toute forme de représentativité (une phrase musicale ne veut rien dire, c’était notre point de départ provocateur), chacun de nous, en tant qu’auditeur, est en condition de lui attribuer des liens représentatifs, en fonction de son histoire et de sa sensibilité. Voilà pourquoi une narratologie de la musique ne sera jamais universelle : la narration perçue par l’auditeur est toujours liée au contexte géographique et anthropologique dans lequel il vit.
Cœur et cerveau concourent ensemble à donner du sens à la musique : un morceau de musique qui nous est cher possède le pouvoir extraordinaire de dire notre histoire. Ce qui constitue, à mon sens, la grande richesse de ce petit fragment, c’est que nous pouvons suivre de près le jeune Pasolini pendant qu’il projette dans la Siciliana son riche imaginaire. J’aime penser que ces mots touchants préfigurent la destinée d’un homme : « c’est de cette fusion […] que naît l’unité, c’est-à-dire la sérénité de la Siciliana. Il y a quelque chose de hautement ému et affligé, un dépassement du mal et du désir même de nous en libérer, qui permet une plénitude de chant ; qui permet le dépassement du drame dans une catharsis permanente […] qui pénètre toute les notes, tous les accords, comme dans la vie il est une douloureuse et poignante résignation. De cette manière, le drame évidé de lui-même se poursuit comme par un mécanisme ensorcelé. […] Les deux voix contrastantes se prêtent le motif, fusionnent dans une double voix de résignation. Cette double voix les dépasse par un abandon au plaisir supérieur du chant, qui semble déborder par sa trop grande douceur ; mieux, par sa trop grande distance. […] Tout paraît dépassé, tout paraît inutile, désormais ; il ne reste plus que cette voix fatiguée qui se répète, qui vit presque par miracle ». Pasolini aimait profondément ce court mouvement pour violon seul, dans lequel, chose rare selon le poète, Bach se montrait profondément humain. Il était séduit par cette « crise » ou Bach semblait, pour une fois, fléchir une céleste, très haute « ligne droite » qu’était immanquablement sa musique. Dans la Siciliana, le discours « est contraste, drame. On y entend deux voix : ce qui signifie qu’on se sent en présence d’un homme ». L’être humain : lacération insoluble, dualisme dissonant et irréconciliable ? Pasolini voyait dans la Siciliana la métaphore d’un processus de dépassement, de rédemption, à partir de ce contraste jamais résolu mais peut-être sublimé, contemplé de loin avec détachement : « chair et esprit ? Plus maintenant. Deux ombres, deux fantômes : les restes de ces deux personnages. Nous sommes en dehors du drame ; […] reste l’accoutumance au chant, désormais entièrement pur. […] La dernière retombée dans le son amoureux habituel et invincible, désespérément affligé, et la réponse immédiate du son sacré, qui se termine avec une douceur résignée et hautement noble, marquent un chaste triomphe de la musique ».
Bruno Rattini
J.S. Bach, Siciliana de la sonate pour violon seul nº 1 en sol mineur, BWV 1001.
https://www.youtube.com/watch?v=NGyjKN1gzk0
Approche rhétorique du concerto brandebourgeois nº 3, BWV 1048, par Claude Abromont :
https://www.youtube.com/watch?v=CbjIyM5GeWE
La traduction des extraits des Studi cités a été réalisée par mes soins.