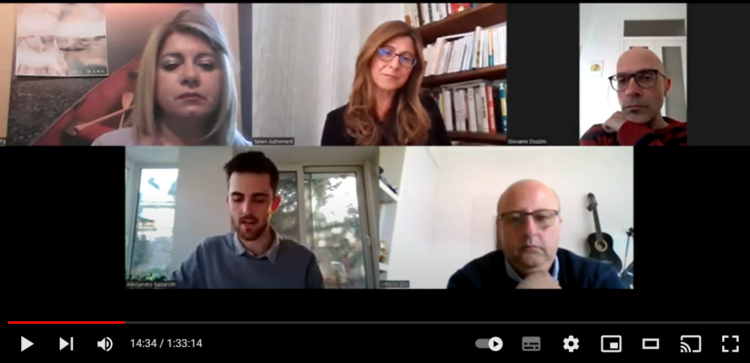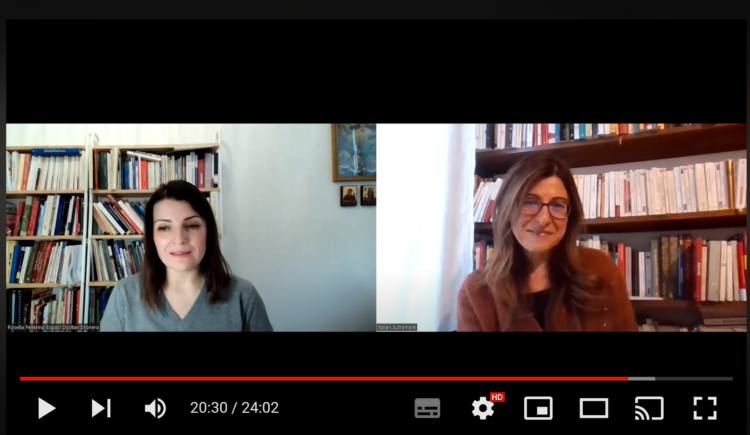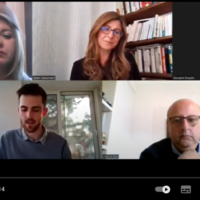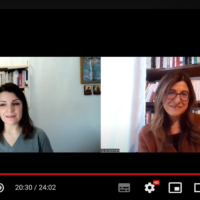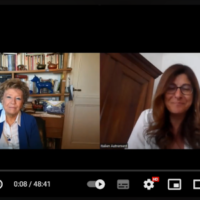Depuis le mois de mars de cette année, Diego Marani est le nouveau directeur de l’Institut Culturel Italien de Paris.
Né à Tresigallo en Emilie Romagne, il a étudié au lycée Ariosto de Ferrare et ensuite à l’Ecole Supérieur de Langues Modernes pour traducteurs et interprètes de Trieste. En 1985 il a commencé à travailler pour le Conseil de l’Union Européenne en qualité de traducteur et, en 2006, il a fait partie de la Direction Générale de la Culture de la Commission Européenne.
Il collabore depuis de nombreuses années à des revues parmi lesquelles le Sole 24 Ore et, en 2020, le ministre de la culture Dario Franceschini l’a nommé président du Centre pour le Livre et la Lecture.
Il a écrit beaucoup de romans traduits dans plus de 15 langues dont certains ont remporté des prix importants. En 2021 il a publié pour La nave di Teseo « La città celeste », un roman de formation situé à Trieste, ville carrefour de langues et de cultures différentes.
Très attentif aux sujets de l’identité et de l’appartenance, Diego Marani qui, en 1995, a inventé par jeu l’europanto, à travers ses œuvres nous invite à regarder vers de nouveaux mondes et vers des cultures différentes sans peur et sans hésitation parce que c’est en acceptant les différences, y compris celles linguistiques, qu’on arrive à mieux se connaître soi-même.
Nous vous proposons une interview qu’il a accordée à notre revue.

Institut Culturel Italien de Paris
Avant d’être nommé directeur de l’Institut italien de Culture, vous aviez déjà vécu à Paris dans les années quatre-vingts comme étudiant à la Sorbonne. Qu’avez-vous ressenti en revenant dans cette ville ?
Pendant de nombreuses années depuis l’université, je suis allé à Paris comme touriste. Le trajet est court depuis Bruxelles. Par contre, retourner pour y vivre a été différent. Le rapprochement entre l’élève sans-le-sou que j’étais et le directeur de l’institut italien de culture le plus prestigieux que je suis devenu, est inévitable. De mon séjour dans les années quatre-vingts je me souviens surtout de deux choses : les funérailles de Sartre et le Resto U de Mabillon. La première parce que j’y ai participé la considérant comme un événement historique. La seconde parce que de toute ma vie je n’ai jamais aussi mal mangé. A l’époque, Paris n’était pour moi que découverte. Une métropole sans fin où il était pourtant facile de vivre. Je me souviens que tout était accessible ; nous pouvions aller aux cours et aux conférences de la Sorbonne sans être soumis à des contrôles et approcher facilement des personnalités importantes. C’était l’époque où la vie à l’étranger représentait le dépaysement total. La France était proche et lointaine à la fois. Les français connaissaient peu les italiens et souvent au travers de lieux communs. Je me souviens d’un numéro de l’Express consacré à l’Italie dont le titre de la couverture, faisant référence à Galilée, était : « Pourtant elle tourné ! » Aujourd’hui les français nous connaissent davantage bien que certains lieux communs et certaines interprétations qu’ils ont de notre réalité aient du mal à disparaitre. Paris est plus proche, plus vivante, plus riche, mais aussi plus complexe à vivre. Mais, c’est peut-être une question d’âge. Quand on a vingt ans tout est merveilleux et à découvrir. Quand on en a soixante le poids de l’expérience nous rend peut-être plus lucides mais il nous enlève tout enchantement.
Les instituts de culture – organismes du Ministère des Affaires Etrangers – peuvent être considérés selon différents points de vue. J’aime les définir comme des lieux de rencontres et d’échanges non seulement pour ceux qui aiment notre pays mais aussi parce qu’ils sont le reflet de cultures différentes. Partagez-vous cette définition et si oui, que pensez-vous faire pour favoriser ces échanges ?
Sur la porte de mon bureau il est écrit « Institut italien de culture » et non « Institut de culture italienne ». Et c’est exactement le rôle que je lui attribue. Un lieu de rencontres, d’échanges et de dialogues entre les cultures italienne et française avec une ouverture vers d’autres cultures encore. Voilà la ligne que je veux poursuivre dans mon programme en présentant des réalités italiennes dans une perspective de dialogue et de rencontres avec des équivalents français.
Dans vos biographies il est souvent écrit que vous êtes ferrarais et vous l’êtes un peu ayant étudié dans cette ville magnifique. Cependant, vous êtes né à Tresigallo, hameau en province de Ferrare. Le fait de venir de la province influencera-t-il votre rôle de directeur ? Je m’explique mieux. Est- ce qu’en France, finalement, on parlera davantage des petits villages italiens très riches culturellement et qui sont si nombreux du nord au sud ?
J’ai grandi en province et c’est la raison pour laquelle je connais bien la problématique des territoires marginaux, souvent aussi riches que nos villes mais oubliés par les circuits de voyage. Le point faible de ces centres, appelés injustement mineurs, est qu’ils sont éparpillés sur des territoires vastes au lieu d’être concentrés dans une seule réalité citoyenne. Un problème qui subsiste aussi en France avec sa province toujours éloignée de Paris. Je voudrais travailler pour corriger ce déséquilibre dans les deux sens : apporter davantage d’Italie mineure en France et le faire aussi en dehors de Paris, dans les territoires qui sont du ressort de l’institut.
Je voudrais maintenant parler de langue en commençant par une de vos inventions qui remonte aux années quatre-vingts dix et qui est, c’est le moins que l’on puisse dire, incroyable : l’europanto, un idiome constitué de toutes les langues d’Europe. Pouvez-vous nous raconter comment est née cette idée de mettre ensemble toutes ces langues et le rôle que cette invention pourrait avoir aujourd’hui où, en pleine crise sanitaire, nous avons assisté à une prolifération de mots anglais ?
L’europanto est une création de 1994 quand j’ai commencé à écrire de courtes chroniques dans cette langue pour des journaux belges et suisses. L’idée, simple et presque banale, vient du fait que les langues se mélangent ; elles se sont toujours mélangées. Mon jeu consiste à systématiser ce mélange en exploitant la compréhensibilité intrinsèque de nombreux mots qui, désormais, n’appartiennent plus à une seule langue comme par exemple pizza, mamma, bundesbank, coiffeur, penalty et d’autres encore apportés par la modernité. Ce vocabulaire, organisé selon une structure vaguement anglaise, que tout le monde comprend un peu, devient alors compréhensible. Voici donc l’europanto, une langue qui, au fond, a été toujours employée par les maitres-nageurs des plages italiennes pour communiquer avec les touristes étrangers. Cependant, mon jeu ne veut pas être une langue universelle. En effet, je ne crois pas aux langues universelles parce que la multiplicité de l’expérience humaine ne peut pas être contenue dans une seule langue. Au contraire, à travers ce jeu, j’ai l’ambition de faire comprendre l’importance de la diversité linguistique et de savoir la valoriser en apprenant les vraies langues. Il faut se rendre compte que les langues n’appartiennent pas à des académies ou à des gouvernements mais aux gens qui les parlent. Pendant longtemps les langues nous ont séparés prétendant définir notre identité et notre appartenance dans l’optique de l’Etat national qui d’ailleurs a été responsable de nombreuses tragédies au XX siècle. Les libérer de ce poids et les considérer comme un patrimoine à partager est un pas en avant vers une Europe des peuples et non des gouvernements. Comprendre la langue de l’autre est l’antidote à l’incompréhension, à la peur, à la méfiance ; c’est la juste recette pour la cohésion et la construction d’un futur commun.
Je voudrais continuer à parler de langues, en particulier des dialectes. Pendant longtemps les dialectes italiens ont été assimilés à l’émigration et à la misère de ceux qui étaient obligés de partir à l’étranger pour se construire un futur meilleur. Aujourd’hui, grâce au travail des spécialistes de la langue, les dialectes commencent à être valorisés. Quels sont les projets de l’Institut Italien de Culture dans ce sens ?
Les dialectes italiens sont la preuve vivante de notre multilinguisme que nous devrions être capables de pratiquer en apprenant aussi d’autres langues. Les italiens sont habitués à la diversité linguistique et trouvent naturel de vivre dans un contexte où dialecte et langue nationale cohabitent, mais ils semblent incapables de s’adapter de la même façon quand il s’agit de parler des langues étrangères. Dans mon programme d’activités je vais donner de la place aux dialectes, mais surtout aux langues minoritaires qui représentent un aspect très important de notre culture.
Trieste et Bruxelles, chacune à sa façon, sont deux villes de confins et des carrefours de cultures. Dans ces villes vous avez étudié et travaillé avant de vous installer à Paris, capitale cosmopolite où cohabitent, bien emplantées dans le tissu social, des ethnies et des cultures différentes. Qu’est-il possible de faire aujourd’hui pour garder vivantes ces diversités sans perdre sa propre identité ?
J’aime définir l’identité comme quelque chose de changeant et non un moule immuable où nous naissons. L’Italie de l’époque où je suis né n’est pas la même que celle d’aujourd’hui, mais il s’agit toujours de l’Italie. Mon italianité, au cours de mon expérience professionnelle et de ma vie, s’est nourrie de beaucoup de diversité sans jamais perdre sa nature profonde. Il ne faut pas avoir peur de changer parce que le changement est inhérent à la nature humaine. Nous ne serons jamais privés d’identité, à aucun moment de notre vie. L’identité est quelque chose qu’il faut cultiver et, plus elles se nourrit de sources différentes, plus elle est vivante et capable de se trouver un futur.
Diego Marani, vous êtes un homme aux multiples identités : écrivain, journaliste, linguiste, éditorialiste, traducteur et aussi romancier. « La bicicletta incantata », « L’amico delle donne (L’ami des femmes) et « Il compagno di scuola » « Nuova grammatica finlandese » (Nouvelle grammaire finnoise) sont les titres de quelques-uns de vos romans. Votre vie me fait penser à une phrase de James Joyce qui d’ailleurs a vécu, comme vous, à Trieste, « La chose la plus importante n’est pas ce que nous écrivons mais comment nous écrivons. L’écrivain moderne doit être avant tout un aventurier ». Partagez-vous cette pensée ?
Le véritable écrivain est toujours un aventurier parce que écrire veut dire créer des mondes, construire des personnages qui vivront même après nous, si nous sommes capables d’écrire des œuvres durables. On ne revient pas en arrière des mondes où l’on s’aventure en écrivant et ce que l’on invente finit par exister réellement, pour nous solliciter à tout moment. Ecrire veut dire explorer mais l’explorateur ne sait jamais ce qu’il trouve et quand il l’a trouvé il ne peut pas le remettre à sa place. Il devient une partie de nous à qui nous avons des comptes à rendre. Celui qui écrit sait qu’il ouvre une porte à travers laquelle peut même entrer ce qu’il ne cherche pas.





Interview de Stefania Graziano-Glockner